De Rosalind Franklin au Covid-19 en passant par l’IA : la science intègre
- amellouzguiti
- 7 févr. 2025
- 7 min de lecture
Dernière mise à jour : 13 févr. 2025
L’histoire des sciences est jalonnée de découvertes brillantes, d’aventures fascinantes, de trajectoires personnelles hors du commun, mais également de scandales. L’une des atteintes les plus marquantes à l’éthique scientifique est celle de l’histoire de Rosalind Franklin et du cliché 51, mettant en évidence la structure à double hélice de l’ADN. Quelques années plus tard, Jocelyn Bell Burnell, astrophysicienne britannique, se voyait déposée du Prix Nobel pour la découverte des pulsars. Autour de ces deux femmes exceptionnelles, des scientifiques ont eu un comportement peu intègre. Entretien avec Bruno Allard, référent à l’intégrité scientifique de l’INSA Lyon, pour brosser le portrait du principe de l’éthique, socle de confiance pour que la science reste un outil pertinent au service du progrès et de l’innovation pour le bien commun.
Dans l’histoire de l’ouverture de la génétique à la modernité, on retient surtout le nom de trois hommes, qui raflaient le prix Nobel pour un cliché dont ils n’étaient pas les auteurs. En octobre 1962, le prix Nobel de médecine est remis à trois hommes : Francis Crick, James Watson et Maurice Wilkins pour « leurs découvertes sur la structure moléculaire des acides nucléiques et sa signification pour la transmission de l'information pour la matière vivante » - autrement dit, pour avoir mis en évidence la structure en double hélice de l’ADN, et ce, en très grande partie grâce au « cliché 51 ». Cette image, obtenue par diffraction de rayons X et interprétée comme la preuve de la structure de l’ADN, avait été prise par Rosalind Franklin, lors de ses expériences au King’s College.
Les trois lauréats du Prix Nobel avaient inversé la preuve, déclarant qu’ils avaient été heureux de pouvoir confirmer leur modèle en voyant l’image de Rosalind Franklin. Or, l’histoire montrera que ce cliché avait servi de base pour bâtir leur modèle. Une double faute donc, vis-à-vis de la scientifique mais aussi vis-à-vis de la vérité scientifique.

Ainsi mise hors course notamment par la volonté délétère de James Watson, alors l’un de ses collègues, doublé du discrédit que l’on portait aux femmes scientifiques de son époque, Rosalind Franklin n’est pas un cas isolé dans les fautes ou vol d’attribution des découvertes scientifiques. Jocelyn Bell Burnell, astrophysicienne britannique, en porte le témoignage vivant. Alors qu’elle perce à jour l’existence des pulsars, des étoiles à neutrons perçues sur Terre par des impulsions brèves et régulières, lors de sa thèse, c’est son maître de stage qui recevra le prix Nobel en 1974.
L’histoire aura pris sa revanche sur l’effet Matilda (1) : le prix Nobel est vite oublié, mais J. Bell Burnell continue à recevoir des témoignages forts. « Cette histoire met en exergue l’héritage anglo-saxon du système de la recherche, sur lequel notre recherche est encore basée, et qui fonctionne sur la rentabilité, la performance, et… l’égo », explique Bruno Allard, chercheur et référent à l’intégrité scientifique à l’INSA Lyon. « Nous sommes également dans un système, le fameux ‘publish or perish’, où il n’y a plus de tempérance. Pour assurer leur carrière, les chercheurs sont poussés à publier le plus possible, pour exister aux yeux de leurs pairs ; il faut être le meilleur ; obtenir tel prix, etc… Le fait est que le nombre d’articles publiés est si exponentiel, qu’il devient même impossible de prendre connaissance de tout ce qui est découvert dans son propre domaine. Et cela est soutenu par un business model ultra rentable, avec des revues prédatrices qui poussent à un rythme de relecture si rapide que leur qualité est questionnable. Il faut que le système évolue, car ces non-dits créent une pression, et entraînent des manquements ou des glissements à l’intégrité scientifique, à différentes échelles bien sûr. »
L’intégrité scientifique : un référentiel
Délimitée dans le code de la recherche par l’article L.211-2, l’intégrité scientifique demeure indispensable au bon fonctionnement des communautés de la science. Elle est le socle d’une relation de confiance entre le monde de la recherche et la société civile, pour assurer que la science soit et reste un outil pertinent au service du progrès et de l’innovation pour le bien commun. L’intégrité scientifique repose ainsi sur 4 piliers : la fiabilité, le respect, l’honnêteté et la responsabilité. « Fiabilité dans la conception, la méthode et l’analyse ; le respect envers les participants, les collègues et les écosystèmes de la recherche ; l’honnêteté dans l’élaboration, l’évaluation et la diffusion de résultats justes complets et objectifs ; et la responsabilité pour les activités de recherche, depuis l’idée jusqu’à la publication ; et enfin la responsabilité dans la prise de parole public du chercheur », explique Bruno Allard.
L'intégrité scientifique est cruciale pour garantir la fiabilité et la crédibilité des recherches et leurs résultats, maintenir la confiance des chercheurs entre eux, mais surtout la confiance de la société et assurer l'avancement solide des connaissances. Elle favorise la transparence et la reproductibilité des résultats, notamment dans des domaines telles que la santé ou l’écologie et l’environnement. Elle a pour but de prévenir les erreurs qui pourraient avoir des conséquences néfastes pour les chercheurs et la société. « Respecter les principes éthiques d’une recherche intègre est un devoir, qui veut protéger la science, la société, et les générations futures de chercheurs ».
Au sein des établissements, un réseau de « référents intégrité scientifique » dont les membres se tiennent à disposition des équipes de recherche. Plagiat, comportement entre personnes, manquement à l’honnêteté et la rigueur, « mon rôle, le cas échéant, sera de contextualiser, et mettre en perspective des recommandations et les normes au sein d’un référentiel et en référer au chef d’établissement. Heureusement à l’INSA Lyon, nos enseignants-chercheurs sont particulièrement bons élèves en la matière et c’est important de le souligner », ajoute Bruno Allard.
Quand un seul fraudeur remet en cause l’équité d’un groupe entier
À chaque époque, sa remise en cause du fonctionnement de la production scientifique. La crise du Covid-19 et la recherche sur les vaccins l’ont bien démontré : une affaire de manquement à l’intégrité scientifique et c’est toute la confiance de la population en la communauté scientifique qui s’en trouve ébranlée. Bruno Allard rappelle : « Il existe plusieurs échelles de ‘violations’, et toutes n’ont pas les mêmes conséquences, il faut être mesuré ». Il peut s’agir de fraudes scientifiques « intentionnelles », comme la fabrication ou la falsification de données ou du recours au plagiat. Les fraudes peuvent conduire à une sanction parce qu’elles sont connues, mais il peut aussi s’agir de pratiques questionnables, comme des pratiques inappropriées qui nuisent à la fiabilité des résultats, comme la rétention, l’omission ou le traitement de données, des segmentations de publication ou même des interactions biaisées avec ses pairs chercheurs. « Il est nécessaire de nourrir une véritable culture académique de l’intégrité scientifique, une sorte de processus volontaire de transformation des valeurs, parfois très abstraites, en normes pragmatiques encadrant la pratique de la recherche ».
À l’échelle internationale, partager des valeurs de référence à l’intégrité scientifique relève d’un défi plus grand. « Selon les pays, il peut y avoir un avancement qui est intègre et derrière, des communications qui le sont moins ! Et puis, il y a les historiques et les enjeux socio-politiques. En Europe, l’Union Européenne a pris en main certains sujets en ratifiant des Acts qui montrent une volonté d’encadrer le bon usage, comme sur l’intelligence artificielle par exemple. Aux États-Unis, la garantie de la liberté et le libéralisme empêchent de légiférer sur l’intégrité scientifique, ce, malgré la volonté de beaucoup de scientifiques américains ». Dans d’autres pays, c’est la différence culturelle qui donne du fil à retordre à la légifération. « En Chine, la notion de copie est une vertu dans le développement de valeur. Le gouvernement chinois a beaucoup de mal à produire des lois sur l’intégrité scientifique. Évidemment, il y a plusieurs lectures à ces difficultés et l’on sent bien qu’on a du mal à avoir des données transparentes de la part de certains pays ; on l’a vu pendant la pandémie. Ce sont autant de défis pour la production d’une science intègre, qui elle, ne s’arrêtent pas aux frontières. »
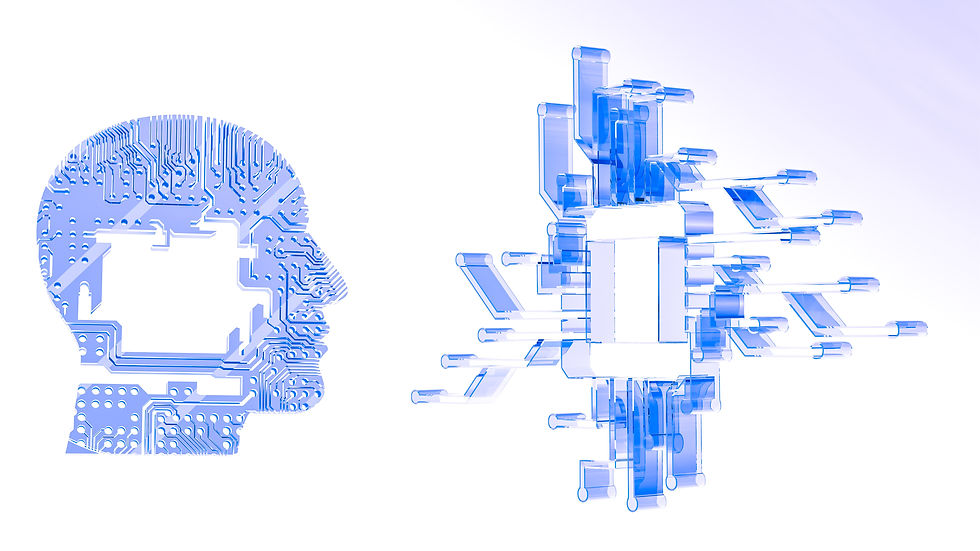
L’intégrité scientifique à l’heure de l’IA
L’IA bouscule les règles établies dans bon nombre de domaines, et la recherche scientifique n'y fait pas exception. La mise à disposition quasi-gratuite et transparente des outils d’intelligence artificielle génératives représente un basculement dans la production de la science. « Il y a une prise de conscience de plus en plus importante, mais il faudra que la communauté scientifique soit rapidement au clair avec ce qu’elle s’autorise à utiliser ou pas et comment elle assurera la transparence sur les résultats liés à l’usage de l’AI », prévient Bruno Allard. « L’IA demande de se positionner, avec ses propres règles et nous ne pourrons pas nous y soustraire ». Et s’astreindre à être honnête et rigoureux à l’heure de l’IA pousse plus loin la formalisation des travaux. « Lorsqu’un chercheur travaille, il doit être capable de justifier ce qui a été fait. Pour cela, il consigne ce qu’il fait, et formalise chaque décision. Parfois, ça leur donne l’impression d’être dans un vase plein, mais ce travail va d’être d’autant plus important quand une IA peut se faire passer pour quelqu’un d’autre… Pour ma part, je crois que la transparence est la meilleure option : si une analyse bibliographique, un texte ou un résultat a été produit par une IA, il ne faut pas s’en cacher d’autant qu’il serait surprenant de s’en priver pour gagner en efficience. »
Ainsi, l’Intelligence Artificielle souligne, une fois de plus, l’importance d’une science intègre pour assurer un progrès solide, juste et crédible. « C’est un sujet qui ne devrait pas seulement être évoqué au gré des scandales, mais doit être inculquée et rappelée régulièrement. La confiance peut être fragile, et pourtant elle est essentielle. On le constate avec l’urgence climatique : sans une adhésion collective aux faits établis, toute action devient presque impossible. Faire vivre l’intégrité scientifique, c’est préserver la crédibilité de la science et réaffirmer son rôle fondamental. »
(1) Effet Matilda : phénomène consistant à minimiser, voire à nier, la contribution des femmes à la recherche scientifique, au profit d'une postérité essentiellement masculine.


